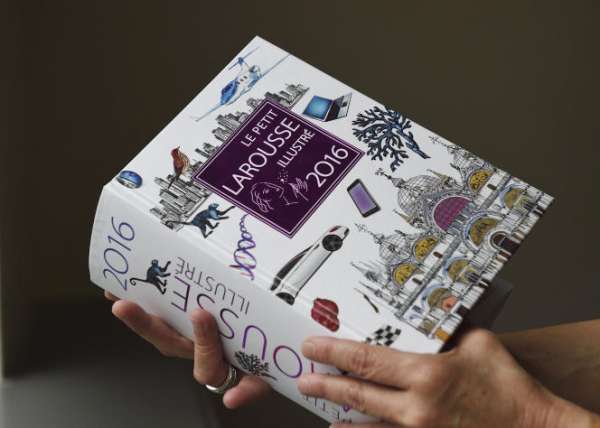L’année 2020 a bouleversé le quotidien des Français mais aussi notre langue. Une évolution que le dictionnaire Larousse a largement prise en considération pour sa nouvelle édition de 2022. A année exceptionnelle, dictionnaire exceptionnel. Au lieu des 150 nouveaux mots intégrés chaque année dans le nouveau dictionnaire, les linguistes ont choisi d’intégrer 170 nouvelles occurrences, selon Le Figaro.
« Je n’avais jamais vu un tel changement linguistique. Cela me rappelle ce qui s’est passé pendant la Révolution française : un bouleversement, l’apparition de mots et de sens nouveaux et surtout une appropriation collective de la langue », commente Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique et conseiller scientifique du Petit Larousse, interrogé par France Info. On retrouve évidemment « SARS-CoV-2 » et « Covid-19 », que les éditions Larousse préfèrent au féminin, mais aussi « asymptomatique », « cluster », « hydroalcoolique », « nasopharyngé », « quatorzaine », « réa » ou encore « télétravailler ».
Parmi les mots moins connus figure « coronapiste », en référence aux pistes cyclables instaurées dans les villes durant la crise sanitaire pour éviter les regroupements de population dans les transports en commun.
« VPN », le « réseau privé qui assure l’anonymat, la confidentialité et la sécurité des informations échangées en ligne, par leur circulation chiffrée à l’intérieur d’un réseau public », fait également son apparition dans le dictionnaire. L’édition 2022 présente également quelques emprunts à la langue anglaise – moins que les années précédentes – comme « click and collect », francisé en « cliqué-retiré ».
« Racisé », « émoji », « mocktail »
Certains mots ont également évolué dans leur signification. « Le mot “confinement”, par exemple, était très rare. Il appartenait au départ à la langue juridique : on confinait les bagnards, puis il est passé au vocabulaire lié à l’énergie nucléaire : le confinement d’un réacteur. Le mot a, ensuite, pris le sens sanitaire bien connu, il s’est développé et son emploi a été constant », raconte M. Cerquiglini, précisant que ce mot a également donné lieu à « déconfinement » et « reconfinement ».
S’agissant des mots qui ne sont pas rattachés à la crise sanitaire, on découvre notamment « mocktail », qui désigne un « cocktail sans alcool ». Mot utilisé depuis longtemps dans le langage parlé, « émoji » est, désormais, intégré dans le dictionnaire Larousse. Il se définit comme « un message électronique et sur les réseaux sociaux, représentation graphique (image fixe ou animée) utilisée pour exprimer une émotion, figurer un personnage, un animal, une action, etc. »
L’année écoulée ayant été marquée de nombreux mouvements sociaux, comme les manifestations contre le racisme, en réaction à la mort aux Etats-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier, le terme « racisé » s’invite dans le dictionnaire : « Se dit de quelqu’un qui est l’objet de perceptions ou de comportements racistes. »
Source: LeMonde
A lire aussi: