Soins oncologiques au Maroc : inégalités, retards et ressources insuffisantes face à une charge croissante
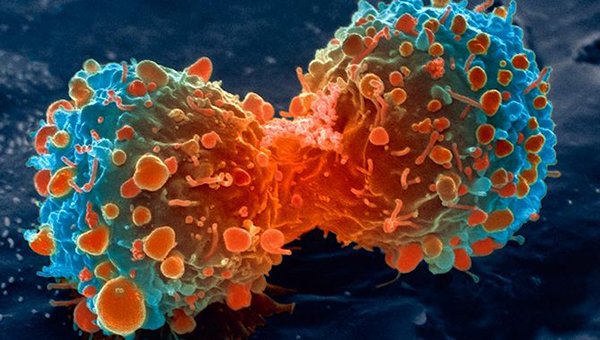
Chaque année, près de 50 000 Marocains sont touchés par le cancer, pour une population de 37 millions d’habitants. L’incidence nationale atteint 137,3 cas pour 100 000 habitants, mais le système de santé peine à suivre cette montée en puissance. Avec seulement 6 % du PIB consacré à la santé et une couverture médicale de 66 %, le Royaume reste loin des standards internationaux, alors que le Plan national de prévention et de contrôle du cancer (PNPCC) et la Fondation Lalla Salma tentent de structurer la prévention et le traitement.
Un rapport récent publié dans l’International Journal of Research and Scientific Innovation dresse un état des lieux préoccupant : disparités régionales criantes, retards diagnostiques, pénurie de spécialistes et équipements insuffisants. Le corridor Casablanca-Rabat concentre la majorité des centres d’oncologie, laissant les zones sahariennes et montagneuses sous-équipées. Les délais moyens de traitement dépassent cinq mois, et près de la moitié des patients ruraux n’ont toujours pas accès à un centre spécialisé.
Les infrastructures restent limitées : en 2020, le pays disposait de 61 IRM (24 publics, 37 privés) et d’un nombre restreint d’unités de mammographie, colposcopie et scanners. Le secteur privé domine l’offre, accentuant les inégalités territoriales. Le manque de professionnels formés à la cancérologie freine la détection précoce et la qualité des soins. Bien que le nombre d’oncologues et de radiothérapeutes ait doublé depuis 2015, leur concentration dans les grandes villes laisse de nombreuses régions sans accompagnement adapté.
Les retards sont également liés à des facteurs sociaux et culturels. La stigmatisation, le poids des croyances et le recours tardif aux soins contribuent aux diagnostics tardifs, notamment chez les femmes. Les barrières financières restent un obstacle majeur : malgré la prise en charge gratuite via le RAMED, les ruptures de stock de médicaments obligent les patients à se tourner vers le privé, avec des coûts parfois insurmontables.
Le rapport recommande un renforcement des infrastructures régionales, le développement de la télémédecine, la multiplication des centres de dépistage, ainsi que la création d’un fonds national de solidarité pour les patients démunis. La formation continue et certifiante du personnel médical, ainsi que l’extension des soins palliatifs au niveau national, figurent également parmi les priorités.
En termes de parcours thérapeutique, les délais diagnostiques varient de 116 jours pour le cancer du sein à 180 jours pour le cancer du col de l’utérus. Les traitements, eux, débutent en moyenne 216 jours après le diagnostic, un retard bien supérieur aux standards internationaux. Ces écarts traduisent l’urgence d’une action coordonnée pour améliorer l’accès aux soins et réduire les inégalités.
Malgré des progrès indéniables depuis la mise en œuvre du PNPCC, le rapport conclut que l’accès aux soins oncologiques au Maroc reste précaire. « Chaque retard diagnostique ou thérapeutique se paie en vies humaines », avertissent les auteurs. Pour garantir l’égalité réelle d’accès aux soins et répondre à la charge croissante du cancer, le Royaume doit investir dans ses infrastructures, renforcer la formation de spécialistes et atténuer les barrières financières et culturelles.
Avec Barlamane

